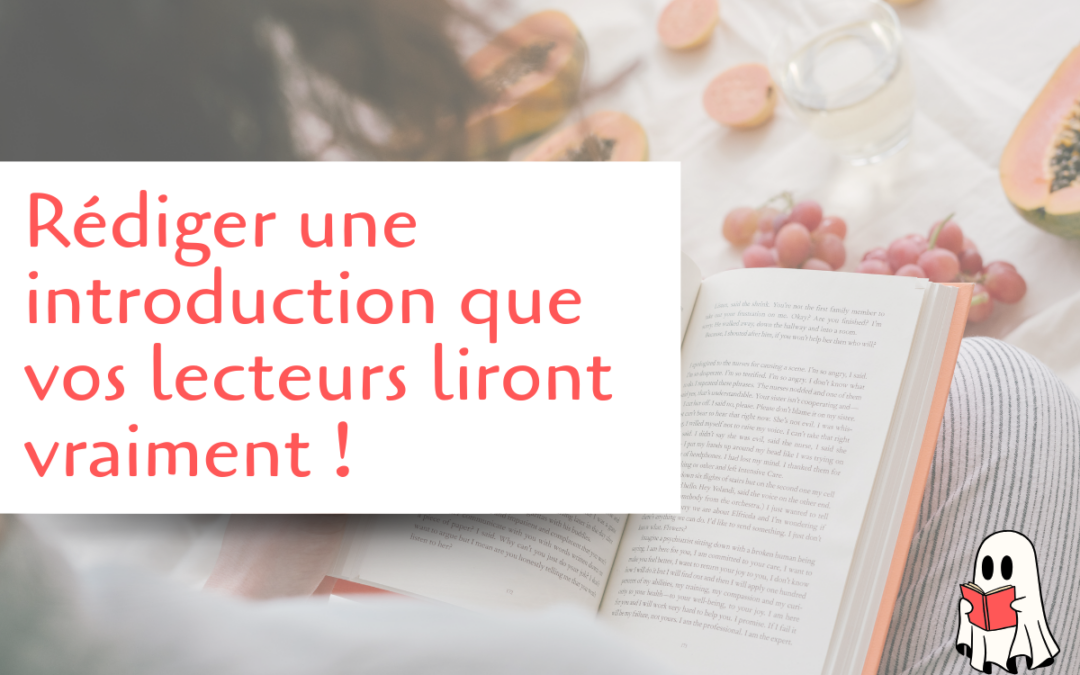Quand j’étais à la fac, j’adorais écrire des introductions. Que ce soit pour des dissertations ou mes travaux de recherche, l’exercice me plaisait parce qu’il me permettait d’échapper aux limites de mon sujet, tout en profitant de l’énergie particulièrement stimulante des débuts de projet.
Un vrai régal.
Pourtant, à présent que je ne fréquente plus les bancs de la Sorbonne et que mon mémoire n’est plus que la relique d’une éphémère gloire passée, j’accorde peu d’importance à ce texte.
Le plus souvent, j’estime que dans l’introduction je ne trouverai pas la solution que je suis venue chercher dans le livre ou que les informations se borneront à un récit, plus ou moins palpitant, de la vie de l’auteur dont je me fous éperdument.
Zéro offense : comme tous les lecteurs, je pense d’abord à moi (et c’est une très bonne habitude dans la vie, si je peux m’improviser coach en développement personnel).
Consciente de ce travers, lorsque je suis amenée à écrire pour mes clients, je me montre donc particulièrement vigilante sur ce passage crucial d’un livre. Je commence à avoir une certaine expérience dans le domaine, alors voici ce que je peux vous conseiller pour écrire une bonne introduction.
Est-ce grave si le lecteur ne lit pas votre introduction ?
Autant répondre tout de suite à cette question : non. Il existe cependant des exceptions.
La première concerne votre marketing.
C’est devenu une pratique courante chez les entrepreneurs d’écrire un livre pour promouvoir de manière indirecte leur activité et augmenter leur notoriété. Dans ce cas, vous pouvez être amené à parler de votre entreprise ou de vos services en introduction. Certains y ajoutent des points de storytelling. Ce serait dommage que le lecteur passe à côté, surtout si vous n’y revenez pas dans le cœur de l’ouvrage (ne le faites pas trop, il n’y a rien de pire qu’un livre qui cherche à vous vendre quelque chose de manière frontale).
L’autre exception est la transmission d’informations cruciales pour la suite de la lecture.
Les guides pratiques, par exemple, demandent parfois à être explicités dans leur utilisation pour permettre aux lecteurs d’en tirer des résultats concrets (et donc de récolter des avis positifs et autres bénéfices non négligeables). De leur côté, les ouvrages théoriques requièrent un état des lieux de certaines théories ou une mise en contexte.
Sans ces informations, la lecture pourrait se trouver amputée d’éléments importants et votre lecteur se sentir perdu. D’autant plus qu’il n’aura pas le réflexe d’aller lire l’introduction qu’il a sautée. Il se contentera, le plus souvent, de reposer votre livre incompréhensible pour en choisir un autre. Il en existe tellement !
C’est là toute la complexité de l’écriture d’une introduction : vous devez tout faire pour donner à votre lecteur l’envie de la parcourir, tout en prenant en compte qu’il ne le fera peut-être pas.
Je vous montre comment ?
Votre introduction = une raison d’être claire et explicite
Écrire une introduction parce que « ça se fait » est une bêtise.
Vous n’êtes plus à l’école, aucun vilain prof de français avec son méchant stylo rouge ne va vous retirer des points.
D’ailleurs une introduction de livre ne correspond pas tout à fait à la structure d’une introduction de dissertation.
Si vous vous souvenez de vos cours de collège/lycée, on vous a appris à :
- Amener le sujet
- Poser la problématique
- Discuter des enjeux de cette problématique
- Annoncer le plan
Dans un livre, vous ne suivrez pas tout à fait les mêmes étapes parce que l’exercice est différent.
Un travail scolaire repose, le plus souvent, sur une démonstration. L’objectif est de prouver que vous savez réfléchir à un sujet et que vous avez des connaissances dans la matière. Vous allez donc mobiliser des notions abordées en cours, les faire dialoguer, les enrichir et proposer une dissertation sur le rôle du rire au théâtre ou l’importance de l’engagement en poésie, par exemple.
Or, dans la plupart des livres de non-fiction, les auteurs cherchent à expliquer, pas à démontrer.
C’est l’œuvre de vulgarisation : rendre accessible une information, une méthode, une technique, etc. Dès lors, exit la notion de problématique (sauf peut-être dans certains livres théoriques qui se rapprochent de productions universitaires).
Les enjeux de votre introduction
L’introduction répond à d’autres enjeux :
- Dresser un état des lieux
- Expliciter un contexte
- Tordre des idées reçues
- Préciser un domaine
- Guider dans l’utilisation du livre
- Appuyer son autorité dans le domaine
- Faire un peu de marketing
Il y a presque autant d’enjeux que de livres et c’est cet enjeu particulier que vous allez devoir identifier pour construire votre introduction.
Que voulez-vous qu’elle apporte au lecteur ? Que doit-il comprendre ou savoir avant de poursuivre ? Doit-il penser quelque chose de vous ? Doit-il poser une action autre que lire le livre ?
En répondant à ces questions, vous trouverez la raison d’être de votre introduction et vous donnerez un but à votre lecteur.
Ce travail ne va pas uniquement nourrir votre réflexion et vous aider à suivre un plan. Vous le mobiliserez à d’autres moments de l’écriture. J’en parle dans le dernier point de cet article.
Vous ne détectez aucun enjeu pour votre introduction ?
Ne l’écrivez pas. Certains très bons livres n’ont pas d’introduction.
Structurez votre introduction pour guider votre lecteur
Pour faciliter la lecture, le style seul ne joue pas. Vous pouvez écrire mieux que Victor Hugo, Racine et Stephen King réunis, si votre introduction semble confuse dans sa progression, les lecteurs ne la liront pas.
J’ai le cas, actuellement, avec un ouvrage client. Le style est tout à fait correct, mais l’auteur passe d’un sujet à un autre, n’assure pas des transitions satisfaisantes et le tout ressemble à un patchwork d’idées qui ont popé en vrac dans sa tête.
Un tel chaos rend la lecture plus difficile parce que le lecteur est forcé de créer les liens lui-même, sur un sujet qu’il ne maîtrise pas forcément.
Cela renvoie, de plus, une image assez brouillonne de votre livre et de votre pensée. Pas l’idéal si vous cherchez à asseoir votre autorité ou que vous souhaitez que le lecteur vous fasse suffisamment confiance pour acheter chez vous.
Il vous faut donc une bonne structure, une trame que vous tisserez fil à après fil, de la manière la plus fluide possible.
Pour commencer, partez de la raison d’être de votre introduction.
Un exemple de structure d’introduction
Prenons un exemple. Vous écrivez un énième livre sur la loi d’attraction. Vous avez conscience que c’est un énième livre sur un sujet surreprésenté. Vous avez compris que votre lecteur l’a peut-être acheté appâté par votre marketing de folie, mais qu’il risque de se montrer suspicieux, prêt à demander un remboursement s’il a la version numérique ou à le déposer dans une boîte à livre s’il a opté pour le format papier. Vous savez que votre première partie reprend des notions usées jusqu’à la moelle sur YouTube, mais que c’est un passage obligé.
La raison d’être de votre introduction sera alors de rassurer le lecteur sur l’intérêt de l’information, sa fraîcheur, son efficacité et de l’exhorter à un peu de patience.
À partir de la raison d’être, vous déterminez donc un état final pour votre lecteur. Dans ce cas, cet état peut se résumer en « OK, je te fais confiance et je ne vais pas abandonner page 15 quand tu me diras comme tous les autres de surveiller mes pensées. ».
Le plan de votre introduction suivra les étapes nécessaires pour que votre lecteur parvienne à cette conclusion.
Ici, on aura quelque chose du genre :
- Je sais que vous en avez marre des bouquins sur la loi d’attraction
- Parce qu’ils disent tous la même chose
- Et qu’en plus ça ne fonctionne pas
- Je le croyais aussi (moment storytelling)
- Mais j’ai finalement réussi parce que X
- Et c’est ce que je vais vous proposer
- Alors oui, il faudra revoir les fondamentaux
- Mais promis je n’y passerai pas trop de temps/je les traiterai différemment/ça vous sera utile parce que Y
- Et à la fin, vous obtiendrez Z
Le principe est de résumer chaque partie de votre introduction en une phrase (ou proposition) qui se lie de manière logique aux autres (pas forcément à chaque fois, mais le plus souvent).
On annonce le plan ?
Les plus perspicaces d’entre vous me demanderont sans doute si on annonce ou pas la progression suivie dans le livre (le plan).
Encore une fois, cette habitude provient de notre système scolaire.
Il s’agit d’une convention dont vous pouvez vous passer ici. Votre lecteur retrouvera ce plan en consultant le sommaire. Si le plan ne sert pas la raison d’être de votre introduction, zappez-le. Inutile d’alourdir le contenu.
En revanche, il peut être intéressant de l’inclure dans certains cas.
J’ai un exemple.
En juin prochain, un livre sortira que j’ai coécrit avec mon mentor. Il s’agit d’un ouvrage sur certaines pratiques spirituelles. L’auteur souhaitait, avant d’aborder la partie full spirituelle, poser des bases très concrètes pour éviter que les gens ne partent dans tous les sens.
On se retrouvait donc avec une première partie plus axée développement personnel concret que spiritualité. Et ça, on devait l’expliquer aux lecteurs.
Nous avons donc fait le choix, dans l’introduction d’annoncer le plan du livre. De cette manière, les lecteurs attirés par le titre explicitement spirituel comprendraient qu’on ne les avait pas arnaqués et qu’ils trouveraient bel et bien ce qu’ils étaient venus chercher.
Mais si vous écrivez un guide pratique sur l’apprentissage du japonais (j’ai commencé depuis plus d’un mois et je ne connais toujours pas mes kanas 😅), un plan aura peu d’intérêt (sauf s’il est particulièrement atypique).
Je pense que vous avez compris le principe, il faut personnaliser en fonction de votre livre et de la raison d’être de votre introduction.
Styliser votre introduction
Une fois que vous avez la raison d’être et la structure, vous pouvez penser à tout ce qui est cosmétique, comme le titre et la longueur.
Commençons par la longueur.
Plus c’est court, mieux c’est. Inutile de vous éterniser, le lecteur aura envie de rentrer rapidement dans le dur. C’est pour cela qu’il a acheté votre livre, pas pour vous entendre pérorer sur Tic ou sur Tac pendant des heures.
Maintenant, le titre.
Honnêtement, une introduction qui s’intitule « Introduction », ça ne fait pas envie. Nommer la partie par sa fonction donne un aspect assez universitaire, formel et vide de sens. Puisque vous vous êtes cassé la tête à trouver une belle raison d’être, c’est le moment de réemployer tout ce temps investi.
Vous souhaitez que votre lecteur comprenne comment utiliser votre livre ?
Intitulez votre introduction « Comment utiliser ce livre » (ou une variante, on s’entend).
Il s’agit de tordre des idées reçues ?
« Le jardinage de rue, ce n’est pas que pour les bobos écolos ».
Vous voyez l’idée.
Il y a cependant une faille.
Que faire lorsque la raison d’être de votre introduction est de nature promotionnelle ?
J’avoue que je sèche à donner une réponse généraliste. La gestion de l’aspect marketing dans un livre mériterait un article à part entière.
Il va vous falloir biaiser un peu. Ce que j’entends par là, c’est que la raison d’être réelle de l’introduction et celle affichée ne peuvent être similaires.
Imaginons, vous êtes coach business et vous voulez que votre lecteur sache dès l’introduction que vous avez de super formations, des programmes qui déchirent et que ce serait bien qu’il ne se contente pas de lire votre livre, mais qu’il aille le plus rapidement possible faire un tour sur votre chaîne YouTube, votre compte LinkedIn, votre blog, votre page de vente ou quoi que ce soit d’autre. On est d’accord que vous ne pouvez pas l’afficher clairement, cela rebuterait et à raison la plupart des lecteurs.
J’ai demandé des remboursements pour moins que ça !
Une solution pourrait être d’orienter l’introduction vers du storytelling. Il serait alors logique que vous parliez de vous, de votre parcours, de votre réussite et donc de vos fameuses formations. Mais à manier avec précaution pour ne pas barber votre lecteur avec le long récit de votre vie ou ne pas le braquer en le laissant croire que vous êtes trop fort.
Point trop n’en faut
Avant de conclure, il y a un point que j’aimerais aborder, la surabondance de textes liminaires (ce sont les écrits qui se trouvent avant le « vrai » début du livre).
Je travaille actuellement sur la bêta-lecture d’un livre qui a : une présentation des auteurs, une préface, un avant-propos, des disclaimers et une introduction. Si vous ajoutez le sommaire et une page de remerciements, le contenu mobilisable commence beaucoup trop tard.
De manière générale, la présentation de l’auteur n’est pas nécessaire : elle peut se faire à la fin ou en 4e de couverture. Ne la conserver que si elle apporte quelque chose au livre dès le début.
La préface n’a de sens que si elle est rédigée par un tiers d’autorité dans votre domaine. Elle vous servira pour votre marketing et rien de plus. Le lecteur sait bien que ce n’est qu’un cirage de pompes (même bienvenu), il ne la lira sans doute pas.
L’avant-propos me semble inutile dans le cas d’une première édition.
D’expérience de lectrice, dans les premières pages de votre livre, mieux vaut vous concentrer sur le fait d’apporter rapidement du contenu agréable et mobilisable à votre lecteur.
Pour résumer, lorsque vous écrivez votre introduction, pensez à :
- Lui trouver une raison d’être
- Construire sa structure autour de cette raison d’être
- La rendre un peu sexy par sa taille mesurée et son titre
Vous pouvez commencer à la rédiger en début de projet d’écriture ou à la fin, ça n’a pas tellement d’incidence à partir du moment où vous êtes prêt à revenir souvent dessus.
Personnellement, j’aime rédiger les introductions rapidement parce qu’elles donnent le ton et permettent de capturer l’esprit du livre, même si elles subissent de nombreuses modifications.
Ça fait partie du jeu !